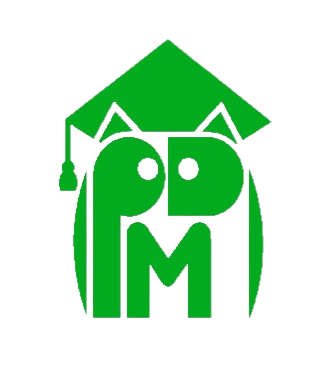Une jeune étudiante de l’université Thunder Bay en Ontario, du nom de Moneet Mann, n’avait que 23 ans quand un médecin lui a annoncé qu’elle était atteinte d’une grave leucémie. C’était la fin de semaine de l’Action de Grâce 2013. Moneet a suivi ses traitements à Toronto près de ses proches, soit notamment d'innombrables transfusions de plasma et de plaquettes additionnées d'une chimiothérapie pour traiter ce qui s’est confirmé être une leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang et de la moelle osseuse qui nuit au fonctionnement des globules blancs. C’est en janvier 2014 qu’on lui a appris que les transfusions et la chimiothérapie ne lui permettraient pas de s’en sortir indemne et que la greffe de cellules souches serait le seul moyen de la sauver. C’est ainsi que, grâce à un donneur allemand anonyme, Moneet est aujourd’hui âgée de 34 ans et s’est mariée avec son petit ami, Nav.
Il existe plein d’autres histoires similaires comme celles de Trish Ganam et de Mackenzie Curran, qui ont toutes deux été sauvées d’une mort certaine par les cellules souches. Ces cellules ont un tel potentiel médical que je voulais absolument en parler.
Il s’agit par ailleurs d’une découverte canadienne des pionniers scientifiques James Till et Ernest McCulloch de l’Institut du cancer de l’Ontario en 1961, lorsqu'ils étudiaient les effets de rayonnements sur la mœlle osseuse de souris. Ils ont ouvert la voie à un nouveau champ de recherche extrêmement vaste connu comme la médecine régénératrice, et même comme la prochaine étape de la médecine moderne selon plusieurs économistes, investisseurs et experts en politiques de santé. En effet, c’est une technique à la fois novatrice et prometteuse pour le traitement de plusieurs cancers, l’insuffisance cardiaque, le diabète, la dégénérescence maculaire de l’œil, l’arthrite et les maladies du Parkinson et de l’Alzheimer. La particularité de la médecine régénératrice (MR) réside dans sa capacité à stopper carrément la progression de maladies considérées comme difficilement curables, voire incurables, plutôt que de se contenter d’en atténuer les symptômes comme les moyens disponibles actuellement. En outre, la chimiothérapie et la radiothérapie entraînent souvent des complications chez le patient qui peuvent se révéler fatales. Alors que sont ces miraculeuses cellules souches? Vous en avez peut-être entendu parler en cours de science, il s’agit simplement de cellules immatures qui ne se sont pas encore spécialisées en un type de cellules particulier (comme les cellules musculaires ou nerveuses). On en trouve dans la moelle osseuse, le sang circulant dans le corps et le sang du cordon ombilical. Par conséquent, elles peuvent, entre autres, se transformer en globules rouges qui transportent l’oxygène, en globules blancs qui défendent l’organisme et en plaquettes essentielles à la coagulation sanguine. Les greffes de cellules souches permettent de régénérer la moelle osseuse après le cancer. En plus de contribuer à la reconstruction de la moelle osseuse, les cellules souches contribuent à protéger l’organisme du patient en attaquant les cellules cancéreuses et permettent la régénération des tissus corporels chez un adulte.
De plus, les Canadiens sont depuis la découverte de ces cellules des leaders dans ce domaine. La première greffe de cellules souches a d’ailleurs été réalisée en 1979 à l’université McGill. Les cellules souches y sont cultivées en laboratoire et il y existe un programme pour lequel travaillent pneumologues, hématologistes et infectiologues qui mènent des recherches sur ce champ encore méconnu et soignent des grands brûlés et des personnes atteintes de maladies graves. Les cellules souches offrent également la possibilité de « fabriquer » les cellules dont on a besoin, comme des celles de peau pour un grand brûlé et certaines spécialisées dans la digestion des sucres et la production d’insuline pour des personnes diabétiques.
Plusieurs projets de recherches sont en cours sur les cellules souches, notamment sur leur implication dans le traitement des maladies génétiques. Par exemple, le professeur Gilbert Bernier au Département des neurosciences à l’Université de Montréal a comme objectif de faire intervenir les cellules souches dans le remplacement de maculas humaines endommagées (zone de la rétine qui permet de voir les images en couleur) par des maculas fabriquées en laboratoire pour traiter la dégénérescence maculaire, une maladie héréditaire qui touche principalement des jeunes et cause, à long-terme, la cécité.
Cependant, les cellules souches ne sont malheureusement pas dénuées de défauts. Leur rapide prolifération dans l’organisme et leur vitesse de division cellulaire très élevée les rendent sujettes au transport de tumeurs et de bactéries nocives. Néanmoins, il reste encore beaucoup de recherches et d’études à réaliser sur ces cellules et j’ai hâte d’en savoir plus!
Si vous voulez vous informer davantage sur le sujet, vous pouvez visiter les sites d’Héma-Québec et de la Société canadienne du sang.
Alicia